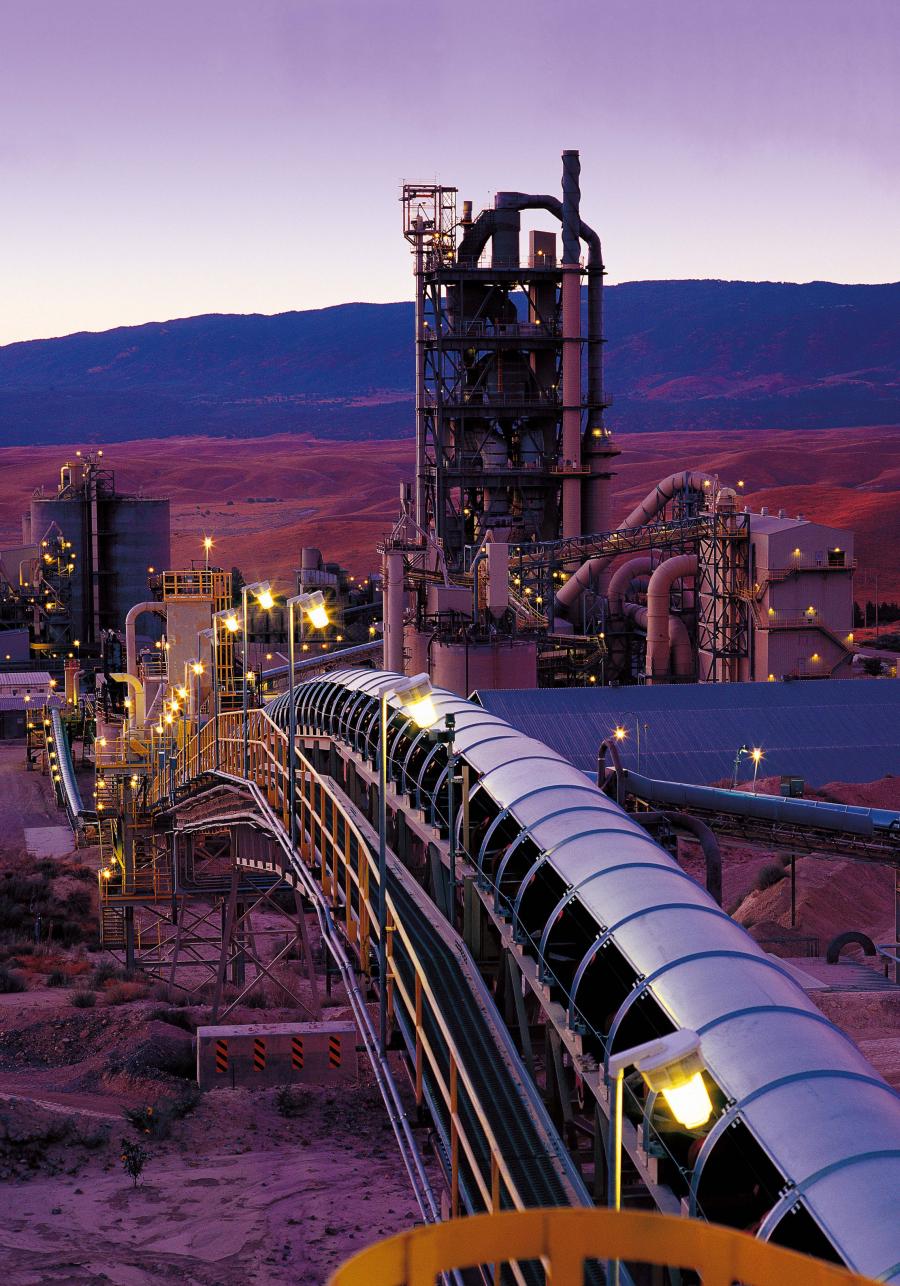La sécurité des produits et la responsabilité du fait des produits : quelles sont les nouveautés intervenues en 2024 et à venir ?
Découvrez la Parole d'expert de Pierre Rousselot, Directeur Sinistres Bessé Industrie & Services et Bessé Agro.

Depuis janvier 2024 la police administrative en matière de sécurité des produits a été réorganisée au niveau national, afin d’aboutir à une Police Sanitaire Unique de l'Alimentation. L’objectif poursuivi est de renforcer l’efficacité et la fréquence des opérations de contrôle de l’effectivité des retraits et rappels.
C’est ainsi que la DGGCRF (ministère de l’Economie) a transféré ses compétences vers la DGAL (ministère de l’Agriculture) en matière de sécurité sanitaire pour l’ensemble du champ de l’alimentation humaine et animale. Si la DGCCRF reste compétente pour lutter contre les pratiques déloyales et frauduleuses, les missions de sécurité et de loyauté des produits alimentaires étant parfois étroitement liées, les deux administrations coopéreront étroitement dans l’intérêt des consommateurs et du marché.
Cette redistribution des moyens et missions de l’organisation administrative française trouve notamment sa source dans l’évolution des textes européens relatifs
- à la sécurité générale des produits (I.)
- à la responsabilité du fait des produits défectueux (II.)
I. Règlement (UE) 2023/988 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits¹
Ce texte est directement applicable depuis le 13 décembre 2024 en France et obligatoire dans tous ses éléments. Ce choix normatif a permis de s’affranchir d’une loi de transposition que nécessitait une Directive. Il abroge ainsi la Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 et la Directive 87/357/CEE du 25 juin 1987.
Le nouveau règlement consolide le cadre général de la sécurité des produits et constitue un socle commun pour tendre vers des obligations plus homogènes entre produits, même si un certain nombre de produits tels que les denrées alimentaires² restent encadrés par des textes spécifiques.
Il s’adresse aux opérateurs économiques en élargissant cette notion pour soumettre certains qui étaient jusqu’alors peu concernés par la réglementation, notamment les places de marché (marketplaces). Les exportateurs de pays tiers devront également déterminer une « personne responsable dans l’UE » qui sera le point de contact des autorités de surveillance en cas de signalement de produits illicites ou dangereux. La volonté de la Commission est que les différents acteurs, qu’ils soient nationaux et internationaux, proposant des produits sur le marché européen aient les mêmes obligations légales, notamment dans la notification aux autorités des produits dangereux dont ils auraient connaissance, via les outils existants dont le Safety Business Gateway.
Les professionnels ont ainsi des obligations renforcées en matière d’évaluation des risques, requise pour chaque type de produits, ainsi que d’information à renseigner permettant la traçabilité des produits (numéro de type, lot ou série ; nom ou raison sociale du fabricant, etc.). Des processus internes doivent également être formalisés, notamment afin de s’assurer de l’existence de procédures adéquates en cas de rappel de produits.
Les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et les objets connectés, sont également visées et devront ainsi être pleinement intégrées dans les analyses de risque réalisées par les fabricants. Leur sécurité sera appréciée lorsqu’elle est liée aux transformations ou modifications « à distance » après commercialisation (mises à jour, fonctions évolutives, cyber-attaque, etc.).
II. Directive 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux³
Celle-ci, qui abroge la directive 85/374/CEE du Conseil, est entrée en vigueur le 9 décembre 2024. La France, comme chaque Etat de l’UE aura deux ans pour transposer celle-ci dans son droit interne.
Le texte adopté fait sensiblement évoluer le texte applicable antérieur : produits concernés, règles de preuve du défaut et du lien de causalité, dommage indemnisable, délai de prescription.

- Le produit : la définition est étendue aux produits numériques et aux logiciels incorporant des technologies d’intelligence artificielle (hors logiciels libres et ouverts fournis en dehors du cadre d’une activité commerciale).
- Le producteur : la définition est étendue à l’« opérateur économique »⁴ et est soumis, lorsque le produit est fabriqué hors UE, au mandataire et au « prestataire de service d’exécution de commande »
- La personne protégée : sont expressément exclus du champ d’application les biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles.
- Le dommage indemnisable : la définition du dommage corporel est étendue ; la perte ou la corruption de données qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles est indemnisée.
- Le défaut et le lien de causalité : la charge de la preuve pour les victimes est facilitée notamment par la mise en place de présomptions spécifiques, et par la nécessité pour les entreprises de fournir certaines informations.
- L'exonération pour risque de développement : la possibilité est conservée.
- Les délais d’action et de prescription : le délai de trois ans pour engager une procédure à la suite du dommage est maintenu, ainsi que celui de prescription de dix ans. Ce dernier sera prolongé, pour les dommages latents qui tardent à se manifester, jusqu’à 25 ans.⁵
Pour une analyse plus détaillée, en l’état de la résolution législative du Parlement Européen du 12 mars 2024 voir article ci-dessous.⁶
Réactions
Ces évolutions règlementaires et législatives traduisent la volonté accrue d’assurer la sécurité des consommateurs, mais également de protéger les opérateurs économiques européens d’une concurrence déloyale de la part des acteurs hors UE. La souveraineté industrielle et alimentaire française et européenne peuvent également être défendues sous cet angle.
Elles vont également conduire à l’accentuation des mesures de prévention et de précaution au sein des entreprises de production et de distribution.⁷
La vigilance dans la bonne mise en œuvre des obligations règlementaires quant à la sécurité des produits contribuera sans aucun doute au maintien de l’assurabilité des entreprises françaises sur le marché des risques de responsabilité civile.
Cette vigilance sera d’autant plus indispensable puisque le Parlement vient de voter le 3 avril 2025 la loi DDADUE qui transpose la Directive n° 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux « actions de groupe ».⁸
Cette loi⁹ élargit et facilite les possibilités de recours à l'action « de groupe » des consommateurs à l’encontre des professionnels. Parmi les dispositions de ce texte, il faut noter la création de l’art. 1254 Code civil suivant :
« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe.
« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui‑ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé.
« Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »
En savoir plus sur la révision de la Directive Responsabilité Civile du fait des Produits défectueux Découvrez l’article publié au BJDA / Lexis 360
P. Rousselot, La révision de la Directive Responsabilité Civile du fait des Produits défectueux 85/374/CEE du 25.07.1985 – Aperçus en l’état du résultat du vote du Parlement Européen du 12 mars 2024l, bjda.fr 2024, n° 93
___________________________________________________________________
¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0988
² Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002
³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402853
⁴ Cf. I. ci-dessus
⁵ Sont plus particulièrement visés ici les dommages corporels
⁶ P. Rousselot, La révision de la Directive Responsabilité Civile du fait des Produits défectueux 85/374/CEE du 25.07.1985 - Aperçus en l'état du résultat du vote du Parlement Européen du 12 mars 2024, bjda.fr 2024, n° 93
⁷ Voir le plan stratégique 2025 – 2028 publié le 13 mars 2025 par la DGCCRF, et la vision stratégique 2024 – 2027 de la DGAL diffusée le 24 septembre 2024
⁸ Laquelle devait être transposée au plus tard le 25 décembre 2022 et qui est applicable à partir du 25 juin 2023…
⁹ Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JORF du 2 mai 2025 (article 16)
Plus de paroles d’expert Bessé
Toutes les actualités ne sont pas traduites